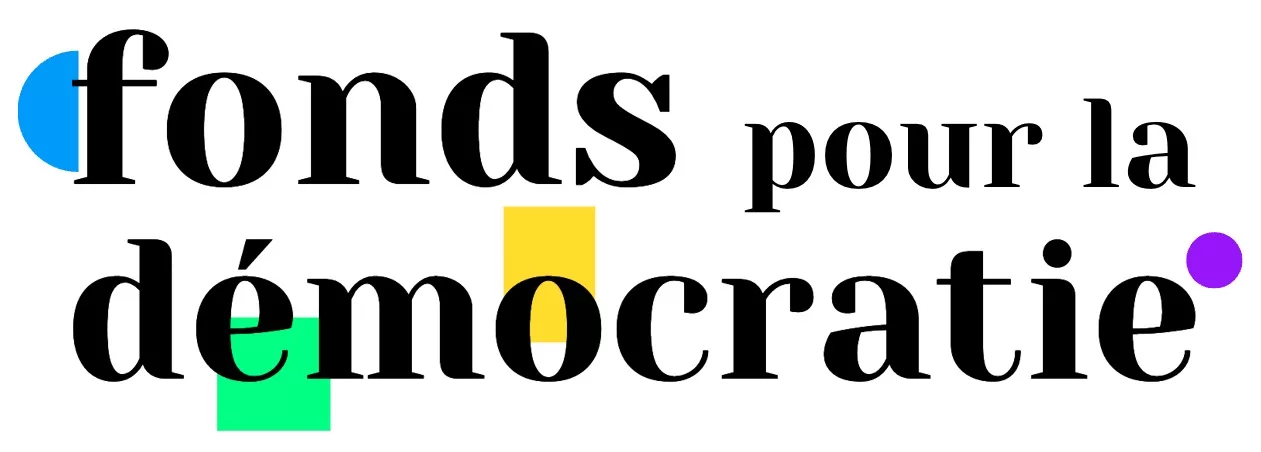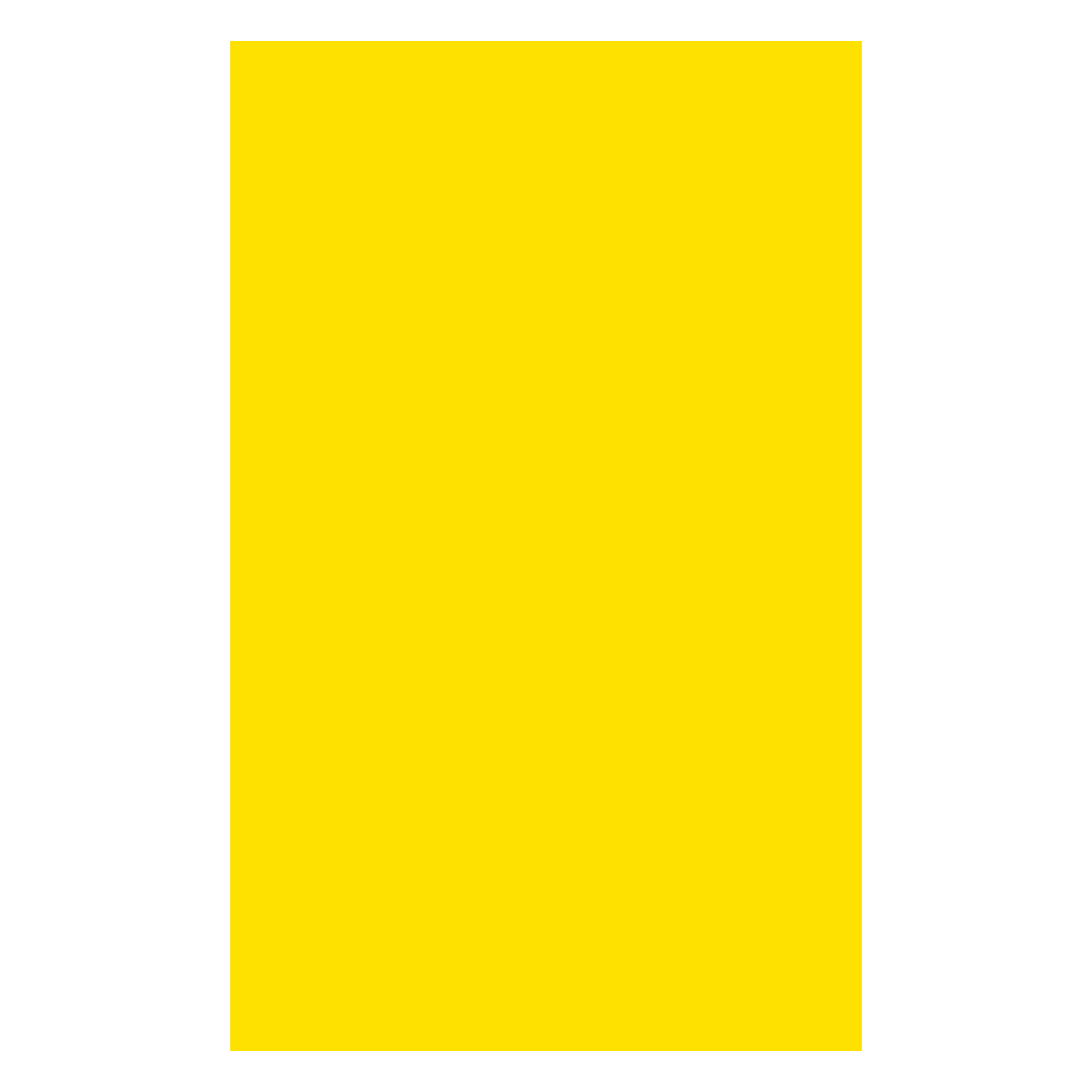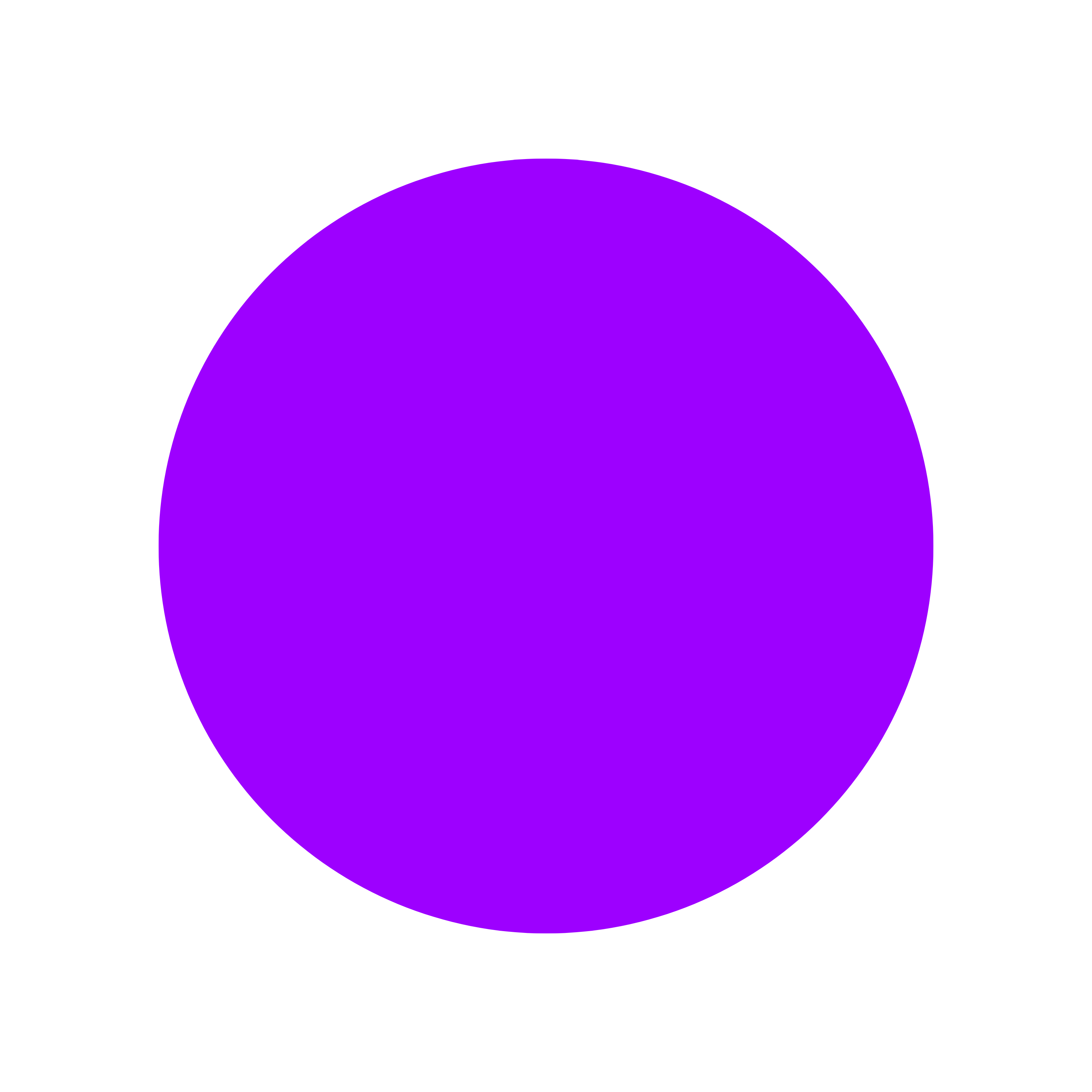Alors que la défiance envers les institutions atteint des niveaux inédits, comment reconstruire un lien de confiance entre citoyen.nes et politiques ? Bruno Cautrès décrypte les racines de cette crise et alerte sur l’urgence de refonder les mécanismes de représentation démocratique.
Bruno Cautrès est chercheur au CNRS, au sein du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po), fondé en 1960.
Le chercheur est en particulier en charge du baromètre de la confiance politique, une enquête menée et publiée chaque année par le CEVIPOF depuis 2009. La seizième vague de l’enquête, rédigée par Bruno Cautrès et publiée en mars 2025 s’articule autour de deux grands axes :
- Le premier porte sur la confiance : la confiance interpersonnelle, la confiance sociale, et la confiance politique, elle-même déclinée en confiance dans les institutions, dans les acteurs politiques et dans les partis politiques.
- Le deuxième aspect concerne l’évaluation du fonctionnement de la démocratie en France, ainsi que ses nouvelles formes d’expression.
Dans votre dernier travail pour le baromètre du CEVIPOF, vous parlez de “défiance politique totale”. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que cela recouvre et ce que cela dit de l’état démocratique du pays aujourd’hui ?
L’enquête, depuis sa création en 2009, montre à quel point le regard que portent les Françaises et les Français sur la vie politique, et les acteurs de la vie politique, est un regard défiant, pessimiste.
Le sentiment que le politique est absolument incapable, de comprendre ce que vivent les gens, voire même incapable d’apporter des solutions.
En 2018, avec la crise des gilets jaunes, on est tombé à des niveaux d’absence de confiance dans l’ensemble des acteurs de la politique, et d’insatisfaction sur le fonctionnement de la démocratie, véritablement vertigineux. Aujourd’hui, dans un contexte de post-dissolution, on revient presque au niveau que nous avons connu au moment de la crise des gilets jaunes. On ne pensait pas que nos courbes reviendraient à un niveau aussi bas.
Pour la vague du baromètre réalisée fin 2024, début 2025, j’ai utilisé le concept de “défiance politique totale” pour exprimer l’idée qu’au fond, il n’y a pratiquement plus aucun segment de l’électorat qui ne soit pas concerné par ce phénomène. Pendant très longtemps, la défiance politique touchait uniquement les personnes les plus exposées aux grandes difficultés de la vie. On trouve désormais des segments de l’électorat auxquels on n’aurait pas pensé il y a 10 ou 15 ans : les classes moyennes, ou encore les cadres supérieurs.
C’est un des résultats vraiment importants de notre enquête, avec sa mise en corrélation avec la très forte insatisfaction sur le fonctionnement de la démocratie.
Dans quelle mesure cette défiance touche différemment certaines personnes en fonction de leur classe sociale et des générations ?
Même si tout le monde est concerné, certains le sont plus que d’autres, évidemment. Les niveaux les plus élevés de défiance se trouvent parmi les catégories les plus précarisées, les plus vulnérables, celles qui ont vraiment le sentiment d’avoir été abandonnées. Elles ont le sentiment qu’on ne s’occupe pas d’elles et qu’elles sont complètement invisibles dans le discours politique. Les personnes les plus affectées par les grandes injustices et inégalités de la vie et de la société sont particulièrement défiantes, et particulièrement insatisfaites du fonctionnement de la démocratie.
Et s’il y a effectivement des phénomènes de génération, les plus jeunes ne sont pas nécessairement les plus défiants. Dès que, au fond, l’expérience de vie montre la fragilité de tout, qu’un rien peut faire basculer la vie de quelqu’un, perdre son travail, ne plus avoir le soutien de sa famille, de ses parents, etc… Là, on observe des niveaux de défiance très importants. Ce qui montre d’ailleurs que l’une des racines de la défiance, c’est le sentiment que le jeu n’est pas fair-play, qu’on joue à un jeu asymétrique, qui demande des efforts aux gens, qui leur demande d’être vertueux, d’être de bons citoyens, mais qui, en retour, ne leur renvoie pas la balle. Donc un jeu asymétrique.
Et les gens ont ce sentiment profondément ancré à propos du discours politique, à propos de la parole politique, qu’après des belles paroles on se retrouve tout seul chez soi avec ses problèmes et on ne voit pas en quoi le politique a pu permettre de changer le destin de quelqu’un. Donc voilà, une dimension vraiment importante de la défiance.
Est-ce que cette défiance est selon vous un rejet de la démocratie elle-même, ou plutôt des institutions qui sont censées la faire vivre ?
C’est beaucoup plus un rejet des institutions, mais la question de la démocratie elle-même s’affirme également beaucoup ces dernières années. Pour donner quelques exemples, depuis plusieurs années, nous demandons aux personnes interrogées dans l’enquête si elles pensent qu’il vaudrait mieux avoir moins de démocratie pour plus d’efficacité. Depuis que nous mesurons cela, environ 40 % répondent oui. Quand on regarde le niveau de satisfaction quant au fonctionnement de la démocratie, on est au mieux autour de 30 %. Il y a vraiment un sentiment fort dans le pays que le système démocratique ne fonctionne pas bien aujourd’hui.
On observe même une demande d’autorité qui est apparue depuis 3 ou 4 ans dans nos données. L’idée qu’un chef autoritaire, qui ne devrait pas se soucier du Parlement ni des élections, gouverne le pays est soutenue par 30 % des personnes interrogées. À la sortie de la crise du Covid, l’idée que l’armée devrait diriger le pays est montée à 27 %, mais ce chiffre s’est stabilisé autour de 20 % depuis. C’est très important.
Selon vous, quelles sont les causes les plus profondes de cette défiance ?
Je pense qu’il y a vraiment deux causes profondes majeures.
La première cause est une très grande transformation du monde.
Dans un ou deux siècles, des historiens seront à notre place et diront qu’il s’est passé quelque chose de très important. Nous vivons une grande transformation appelée la mondialisation, qui est à la fois une expérience humaine exceptionnelle ; c’est quelque chose d’aussi important que les grandes révolutions technologiques survenues au cours des siècles précédents, mais qui introduit aussi, partout dans le monde et dans tous les pays, des éléments de crainte, d’incertitude, ce sentiment que tout peut être remis en cause du jour au lendemain.
Les années 50-60 ne donnaient pas aux gens ce sentiment que tout pouvait être remis en cause constamment. Je pense donc que cette défiance est causée par ce bouleversement majeur du monde qui touche particulièrement les pays occidentaux, et notamment européens. Parmi eux, la France est sans aucun doute le pays le plus exposé à vivre cela de manière douloureuse, car elle porte un rêve de grandeur et d’unité.
La deuxième cause est la crise de l’ascenseur social.
Même si le politique fait de beaux discours, il délivre en réalité assez peu. Du moins, c’est la perception subjective des gens : le système est trop verrouillé. Sur le terrain de notre enquête, on constate que c’est un problème particulièrement aigu en France, plus marqué que dans d’autres pays. L’idée que ne pas avoir de diplôme est une catastrophe est très présente. Notre système de rétribution des mérites et des talents est en contradiction empirique avec le discours politique, qui prône la fraternité et l’égalité républicaine. Beaucoup nous disent : « J’ai fait ce qu’on m’avait dit de faire, on m’avait promis que si je travaillais bien à l’école, des choses formidables arriveraient, je l’ai fait, et ça ne marche pas. » C’est ce sentiment d’asymétrie qui est profondément lié à la défiance.
Dans notre enquête, 70 % des personnes estiment que les élus sont corrompus. Nous savons que ce n’est pas vrai : il y a parfois des cas de corruption, comme dans tous les milieux, mais la grande majorité des politiques sont des personnes de conviction qui veulent le bien public. Cependant, ils sont comme prisonniers d’une cage qui empêche les citoyens de voir ce qu’ils font. C’est pourquoi, dans notre enquête, on remarque que la confiance envers les élus locaux reste bien plus élevée.
Il y a sans doute une troisième racine de la défiance qui est une dimension historique de beaucoup plus longue durée dans la société française, qui est la méfiance de la société vis-à-vis du politique qui le lui rend bien. Je ne dirais pas qu’on est le pays où le politique et l’État fait le plus confiance à la société civile. Il faudrait sans doute pour améliorer les choses, enclencher une grande révolution vraiment de la confiance de l’État et de l’administration dans la société et dans la société civile.
Quel rôle les associations, les collectifs citoyens, les initiatives locales peuvent jouer répondre à cette crise démocratique ?
D’abord, ce qui me surprend, dans le cadre d’une étude à laquelle je participe sur la revitalisation du civisme, où l’on auditionne de nombreuses associations et acteurs de la société civile, c’est la richesse incroyable des propositions qui en émanent.
J’ai par exemple auditionné quelqu’un de l’UNICEF, engagé pour les droits politiques des enfants et favorable au droit de vote à 16 ans. D’autres associations mènent un travail remarquable d’éducation populaire pour apprendre aux jeunes le fonctionnement des institutions. Il y a partout en France des trésors d’initiatives, une vraie bonne volonté collective, des personnes qui souhaitent sincèrement que la démocratie fonctionne mieux.
Le problème, à mes yeux, n’est pas dans la société civile, mais dans le politique. La vraie question est : comment faire en sorte que le politique se nourrisse de cette énergie ?Je pense qu’il y a là un problème institutionnel. Il manque des mécanismes, une forme de tuyauterie démocratique entre les dynamiques citoyennes, comme les conventions citoyennes, et le Parlement. C’est ce qu’on appelle souvent « le dernier kilomètre » : celui qui relie les propositions issues de la société à leur concrétisation politique. Aujourd’hui, il n’est pas évident de comprendre comment les conclusions d’une convention citoyenne, comme celle sur le climat, parviennent jusqu’à l’Assemblée. Or, on ne peut ni attendre du Parlement qu’il se contente d’entériner ces conclusions, ni considérer que les citoyens engagés dans ces processus participatifs n’ont finalement qu’un rôle consultatif, pendant que les « vrais débats » se passent ailleurs.
Il est donc urgent de revitaliser notre modèle institutionnel, en recréant ou en consolidant des courroies de transmission entre la société civile et la sphère politique.
J’ai quelques espoirs du côté du CESE : il incarne une vraie volonté de réintégrer le citoyen dans les institutions, que ce soit par les conventions citoyennes ou le dialogue social qu’il porte. Mais le travail du CESE reste encore trop peu connu.
Vous avez observé depuis plusieurs années l’évolution du rapport des Français.es à la démocratie. Quelles sont vos recommendations prioritaires pour reconstruire la confiance ?
D’abord, je pense qu’il ne devrait pas être possible de faire carrière en politique. On devrait imaginer que chaque citoyen dispose, à sa naissance, d’un crédit d’années qu’il peut choisir de consacrer au bien public à travers des fonctions électives ou exécutives. L’idée que les détenteurs de fonctions exécutives ne sont que de passage est, à mes yeux, profondément démocratique.
Il y a aussi un enjeu fondamental autour du renouvellement du vivier des représentants et de l’évaluation de l’action publique. On entend souvent, dans les enquêtes, un sentiment d’opacité : les citoyens ne savent pas ce que font les élus dans les assemblées. Le politique, au niveau national, semble incapable de rendre des comptes.
À l’échelle locale, c’est différent : la majorité des maires publient des bulletins d’information, communiquent sur leurs engagements, indiquent ce qui a été fait, à quelles dates, etc. Il existe un lien de redevabilité. Mais au niveau national, ce lien est quasiment inexistant.
Comment imaginez-vous la démocratie française dans 10 ans, dans le meilleur des cas ?
Je pense que, dans dix ans, si l’on adopte une hypothèse optimiste, nous aurons accompli des progrès dans cette direction, parce que les demandes venant de l’opinion publique et de la société civile dans son ensemble sont considérables. Le politique ne pourra pas les ignorer indéfiniment.
Un point positif, c’est qu’il existe un lien important entre l’adhésion aux normes de la pensée démocratique et l’éducation. L’éducation enseigne d’abord que tout est complexe, que personne ne détient de réponse simple, et elle apprend à dialoguer avec les idées des autres, ce qui est fondamental.
Ce qui est encourageant, c’est que nous avons, dans les sociétés européennes, le privilège de vivre dans des sociétés qui investissent fortement dans l’éducation. Cet investissement se poursuit malgré les aléas politiques, les alternances de majorité. Globalement, ce sont des sociétés dans lesquelles le niveau de compétence, le niveau d’éducation de la population est élevé, et où la valeur accordée à l’éducation reste très forte.
Sur le long terme, cette élévation progressive des niveaux d’éducation est porteuse d’optimisme, à condition que le système éducatif, et le système de rétribution des talents, sachent mieux qu’auparavant reconnaître et valoriser des profils diversifiés.
Entretien réalisé par Aminata Dembélé